
Signature d’Adolphe Lair (ADML)
Adolphe Lair naît à Saint Georges sur Loire le 10 juillet 1834. Son père, Epiphane Lair, y est notaire et d’Adélaïde Lefebvre, d’origine vendéenne. Adolphe est fils unique et réside à la Comterie dans une bâtisse qui date du XVIIème. A l’âge de 11 ans, son père l’envoie au lycée d’Angers mais souhaitant suivre l’éducation de son fils, il déménage son étude à Angers. De 1845 à 1852, Adolphe se distingue dans toutes les matières, prix d’honneur en rhétorique et en philosophie. Le brillant élève noue une amitié avec un jeune professeur, Adolphe Perraud, futur évêque d’Autun et membre de l’Académie Française. Cette relation perdurera toutes leur vie.
En 1852, Adolphe s’inscrit à la Faculté de Droit de Paris. Il y recevra chaque semaine la visite d’Adolphe Perraud. Adolphe Lair est licencié en 1854, il est reçu docteur en 1859 soutenant une thèse sur la réhabilitation des condamnés. Il fait des stages d’avocat au Barreau de Paris et assiste avec un grand intérêt aux procès politiques. Ouvert d’esprit, il poursuit sa formation intellectuelle, suivant des cours de philosophie, de littérature et même de sciences à la Sorbonne et au collège de France. Adolphe Lair étudie pendant dix ans, faisant preuve d’une véritable soif de savoir et profitant de rencontres estimables. Dès son arrivée à Paris, il est accueillie par Jean-Philibert Damiron, philosophe et membre de l’Académie des Sciences morales et politiques. Il s’y nourrit de sa doctrine et de ses leçons. Chez le philosophe, il rencontre Paul François Dubois, un universitaire de haut rang, ancien directeur de l’école normale supérieur, Etienne Vacherot, philosophe et homme politique ou encore, Charles Waddington, philosophe.
Adolphe Lair évolue donc durant dix ans dans cette élite intellectuelle, stimulante et au combien enrichissante. Il songe à devenir professeur à la Faculté de Droit mais il choisit finalement la magistrature. Le jeune avocat est reçu par Delangle, le garde des Sceaux, qui apprécie très vite les qualités de l’homme. En février 1862, Adolphe Lair est nommé substitut du procureur impérial à Cholet, tribunal d’importance qui le rapproche de sa famille. Il quitte avec peine Paris et son groupe d’intellectuels pour se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions avec talent. Son avancement est rapide. En 1865, il devient substitut du procureur impérial à Laval puis en 1867 à Beaugé. En cinq ans, son seul mérite lui permet de franchir tous ces grades.
Le 22 juillet 1867, Adolphe Lair épouse à Angers Louise Talbot, fille d’Eugène Talbot, avocat général reconnu. Le couple s’installe à Beaugé ; un fils, Paul-Eugène, naît ; c’est une existence heureuse. Mais en 1870, la guerre éclate et alors que le second empire s’écroule, des révoltes éclatent dans l’arrondissement de Beaugé. Des fermes, des bois, des châteaux sont mis à feu alors qu’il ne reste que deux gendarmes pour veiller à l’ordre public, suite à la réquisition du 4 septembre. Adolphe Lair, assisté de quelques hommes de bonne volonté, prend les armes et se rend sur le terrain pour maintenir le calme.
Mais le nouveau gouvernement lance une purge dans la magistrature : le procureur général est révoqué. Pour ne pas demeurer sous les ordres de son remplaçant, 18 magistrats du ressort d’Angers donne leur démission. Adolphe Lair en fait partie. Il quitte Beaugé, non sans peine, et rejoint la garde nationale à Angers. A la fin de l’année 1870, Adolphe Lair souffre d’une grave fièvre scarlatine. Il perd subitement sa mère dont il était très proche. Affecté par la situation politique, le contexte de guerre avec la Prusse puis le climat insurrectionnel de la Commune, Adolphe Lair traversent douloureusement ces longs mois. Au mois de juin 1871, le Garde des Sceaux Dufaure le nomme substitut du procureur général près la cour d’Angers aux côtés de Louis Gain, avec qui il va se lier d’une profonde amitié. Les deux hommes sont complémentaires et un travail exemplaire au Parquet. En 1872, nait le second fils du couple Lair, Maurice.
En 1873, Louis Gain devient procureur de la République à Angers. Jean Ernoul, le Garde des Sceaux, propose à Adolphe Lair de devenir son chef de cabinet. C’est pour Adolphe la certitude d’un bel avenir, le retour à Paris qu’il a tant appréciée. Mais son père est gravement malade et Adolphe renonce à ses ambitions pour rester auprès de lui. L’année suivant il refuse pour les mêmes raisons, un poste d’avocat général et demande un siège de Conseiller à la Cour qu’il obtient, pour se fixer en Anjou. Il va occuper se poste durant neuf ans. C’est à cette période qu’il fait construire l’actuel château de la Comterie.

Le château de la Comterie
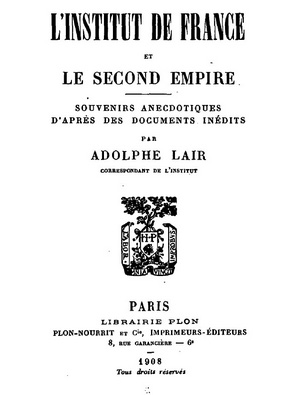
La page titre d’un des derniers ouvrages d’Adolphe Lair tiré des papiers de Dubois
Mais la Cour d’Angers déplaît : elle compte en son sein trop de libres volontés et trop d’esprits impartiaux. Sous le couvert d’une réduction de personnel, 16 magistrats sur les 21 sont écartés de leur siège par la loi d’épuration du 30 août 1883. Adolphe Lair n’en fait pas partie mais il donne sa démission en signe de protestation. Il écrit dans ses notes : « Il est à craindre que, désormais, tous les pouvoirs qui se succéderont en France ne s’empressent, à l’envi, de chercher des juges à eux et ne portent, par représailles, de nouveaux coups à l’indépendance des magistrats. Ce jour-là, ce sera fait pour jamais de la justice… »
En 1883, Adolphe Lair a déjà publié de nombreux ouvrages principalement des commentaires des Lois et de la Jurisprudence. Profitant d’une liberté nouvelle, il va se consacrer à l’écriture. Il va rédiger des articles pour la Revue d’Anjou ou pour le Correspondant. A partir de 1898, Adolphe Lair va se consacrer à retracer la période où il résidait à Paris et côtoyait les cercles philosophiques. Il va publier des documents inédits de Dubois et Damiron ainsi que la correspondance de Théodore Jouffroy. Ce travail colossal va l’occuper pendant dix ans.
Adolphe Lair meurt à Angers, le 16 février 1910. L’annonce de son décès suscite un certain émoi dans les cercles littéraires et intellectuels auxquels il contribuait comme l’académie des sciences morales et politiques de Paris. A ses obsèques à Angers, ses amis, ses anciens collègues et la population respectueuse de son travail lui rendent un dernier hommage. Puis son corps est inhumé au cimetière de Saint Georges aux côtés de ses parents. Son fils Maurice, sera maire de Saint Georges de 1922 à 1945. Sa femme Louise, décède en 1932.
Sources :
Georges Belin, Un magistrat : Adolphe Lair, Revue d’Anjou, tome 62, p.162-194 et 271-282, 1911.